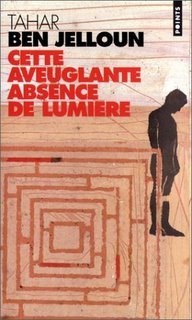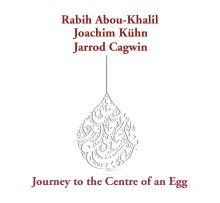Lundi, Cecci et moi sommes allés voir Rabih Abou Khalil à la Cigale.
On avait choisi ce concert pour un certain nombre de mauvaises raisons :
1) il était programmé dans le cadre du JVC Jazz Festival, qui nous avait déjà fait découvrir Buddy Guy au Rex, sans doute le meilleur concert de ma vie.
2) on connaissait l'artiste, car Cecci en possédait quelques disques quand nous nous sommes rencontrés. Disques que je trouvais agréables, faciles à écouter, mais dont j'aurais été bien incapables de fredonner une mélodie (sauf le titre Blue Camel)
3) on aime bien la Cigale où nous avions déjà vu les Wriggles (ce qui n'a rien à voir).
Tout ça annonçait le concert foiré. J'avoue, je suis parfois pessimiste.
A vrai dire, je ne comprends rien au jazz. Je ne suis pas musicien et c'est une musique beaucoup trop compliquée pour moi. La plupart des disques de jazz me font baîller parce qu'ils n'arrivent pas à retenir mon attention. Souvent, je les passe quand on reçoit des invités parce qu'ils mettent une belle ambiance dorée et qu'ils ne gênent pas la conversation.
Je n'y comprends rien, mais j'aime bien quand même et quelques artistes, via leurs disques, ont réussi à me toucher : Django Reinhardt et Chet Baker... Mais ne nous éloignons pas trop loin de la Cigale.
En première partie, Thierry "Titi" Robin et son trio (guitare/oud/bouzouk + accordéon + percus) assurent une demi-douzaine de morceaux très agréables dont la joyeuse énergie me ravit. Ca sonne très fort, c'est bon enfant, le percussionniste a l'air complètement fou, c'est très agréable, le public est séduit.
En seconde partie, éclairage intimiste, un grand piano noir s'est glissé sur la scène comme une grosse bête intimidante. Les artistes rentrent, on les distingue à peine. Je devine que Abou Khalil est cette silhouette recroquevillée sur son oud (sorte de luth arabe). Une grosse batterie brillante fait face au piano côté jardin. On sent que la musique va être autrement plus sérieuse qu'en première partie.
Ca y est, ça commence. Notes de piano. Pincement de l'oud entremêlés de silences. Scintillements planants de la batterie. Le piano et l'oud ont l'air d'être ennemis, les sons de ces instruments me paraissent tout à fait discordants, je me dis que la partie n'est pas gagnée.
Le pianiste (Joachim Kühn, co-compositeur de tous les morceaux) a l'air fou. Il hoche la tête bizarrement, est tout tordu sur son piano. Tout à l'heure, il se lèvera et prendra son saxo pour en faire des solos de possédé, comme le personnage de Bill Pullmann dans Lost Highway. Et Abou Khalil ne bouge quasiment pas, sauf un peu les épaules, tout concentré, recroquevillée, resserré sur son instrument. Seul le batteur a l'air à peu près sain, mais ça ne va pas durer.
Et les morceaux progressent, l'oud et le piano semblent se rapprocher, des rythmes naissent, des échos de l'un à l'autre encadrés par de longues vibrations de batterie.
Ca s'amplifie, ça rebondit, ça monte, ça sonne, ça me scotche sur mon siège. Les instruments sont amplifiés, un gros son remplit l'obscurité de la salle de concert, un gros son qui fait trembler les murs, qui me résonne dans la poitrine. C'est du jazz, ça? Ces grosses vibrations, ces échos piquants d'oud et de piano? Si ça c'est du jazz, alors je veux bien écouter du jazz toute ma vie!
Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas arracher les chaises? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas secouer la tête gros un gros fan de Nirvana?
Les morceaux défilent, rapides ou calmes, gais ou mélancoliques, introduits avec humour par Abou Khalil qui, à ce seul moment, paraît se détacher un peu de son instrument.
Moi, je suis conquis, séduit, j'oublie tout, je plonge dans une grande vibration syncopée. Cecci aime aussi, on se serre très fort pour écouter, je ressors tout rêveur et planant sur le boulevard. Waow.
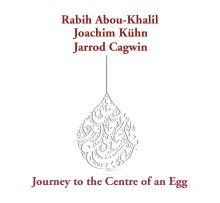
Bien sûr, j'ai acheté le disque en sortant de la salle. Petite déception, il est tout en finesse, subtilité et discrétion, quand le concert passait en force. Encore de la musique trop compliquée pour moi. Mais je l'écouterai avec plaisir, en me souvenant de ces moments possédés.