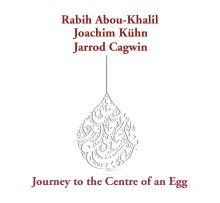Carthage et sa civilisation cruelle du temps d’Hamilcar Barca sont le centre et le principal sujet de ce livre. L’auteur prétend dans une petite annexe s’être énormément documenté et avoir tout lu sur son sujet, sans doute pour faire croire aux critiques littéraires qu’il a écrit un roman historique, genre à la mode de nos jours. Mais il n’y a pas besoin de beaucoup creuser pour se rendre compte qu’il ne s’agit pas là d’un tas d’érudition mal digérée et de références empilées les unes sur les autres, mais d’une puissante rêverie, d’un monde imaginaire fou et chatoyant, d’une Carthage aussi irréelle et fantasmée que le sont les dieux et héros des tableaux de Gustave Moreau.
Ce monsieur Flaubert écrase de son ombre tous les auteurs francophones qui ont essayé de marcher sur les pas de Tolkien. Quelles images incroyables ! Quelle cohérence, quelle harmonie, entre les Dieux, les palais, les paysages, les vêtements ! Les étonnantes sonorités des noms de lieux, personnages, matières et pierres précieuses nous transportent dans un ailleurs lointain. Dans une civilisation qui ne peut nous être qu’étrangère puisque vaincue et disparue sans quasiment laisser de traces, mais où l’on trouve des hommes dans les sentiments desquels on peut se reconnaître.
Je n’ai encore rien dit de l’intrigue, foisonnante, complexe, remarquable. On y trouvera, sans ennui aucun, des scènes de batailles, une fête extraordinaire, de la politique, de la magie, le cambriolage d’un temple sacré (digne de Fafhrd et le souricier gris !), des ruses mortelles, des sacrifices humains… et des batailles, encore. Il y est question de la guerre d’une vieille cité contre ses mercenaires, de l’amour impossible d’un barbare pour une princesse perdue dans sa quête mystique. La vie, partout, est présente. On meurt beaucoup, dans Salammbô, le sang coule, mais c’est pour mieux régénérer le monde.
 L’auteur anglo-saxon dont l’imaginaire de Gustave Flaubert se rapproche le plus est sans doute Michael Moorcock, celui d’Elric et surtout de Gloriana : comme lui, le Français aime les univers baroques, les fins du monde bariolées, les atmosphère à l’érotisme étrange… Mais que le lecteur se rassure : point de trilogie interminable ici ! Le roman est d’un seul tenant, dense, équilibré, parfaitement construit, de la scène d’introduction à l’étonnante et nécessaire chute. Comme chez Tolkien, l’univers est complet, cohérent et maîtrisé, il semble même être le but et le fondement de l’œuvre. Les batailles sont aussi épiques et sanglantes que celles de Robert Howard, et j’ai déjà mentionné la surprenante parenté avec les livres de Fritz Leiber.
L’auteur anglo-saxon dont l’imaginaire de Gustave Flaubert se rapproche le plus est sans doute Michael Moorcock, celui d’Elric et surtout de Gloriana : comme lui, le Français aime les univers baroques, les fins du monde bariolées, les atmosphère à l’érotisme étrange… Mais que le lecteur se rassure : point de trilogie interminable ici ! Le roman est d’un seul tenant, dense, équilibré, parfaitement construit, de la scène d’introduction à l’étonnante et nécessaire chute. Comme chez Tolkien, l’univers est complet, cohérent et maîtrisé, il semble même être le but et le fondement de l’œuvre. Les batailles sont aussi épiques et sanglantes que celles de Robert Howard, et j’ai déjà mentionné la surprenante parenté avec les livres de Fritz Leiber.Mais contrairement à tous ces auteurs que je ne peux lire que traduits, notre auteur est francophone et son roman est servi par une langue fabuleuse qui est la véritable porte d’entrée de son monde imaginaire, qui amène toute la vérité de ce songe. Il n’y a qu’avec Nôo, de Stefan Wul, que je me suis senti ainsi transporté par la magie de l’écriture.
Avec Salammbô, Gustave Flaubert a donné à la littérature française de l’imaginaire une œuvre incontournable pour tous les amateurs du genre. On ne peut que lui souhaiter une longue et fructueuse carrière !
Ref : Salammbô – Gustave Flaubert - éditions Folio, etc.
PS : admirez au passage la qualité de l'illustration de couverture!
PS : admirez au passage la qualité de l'illustration de couverture!