


















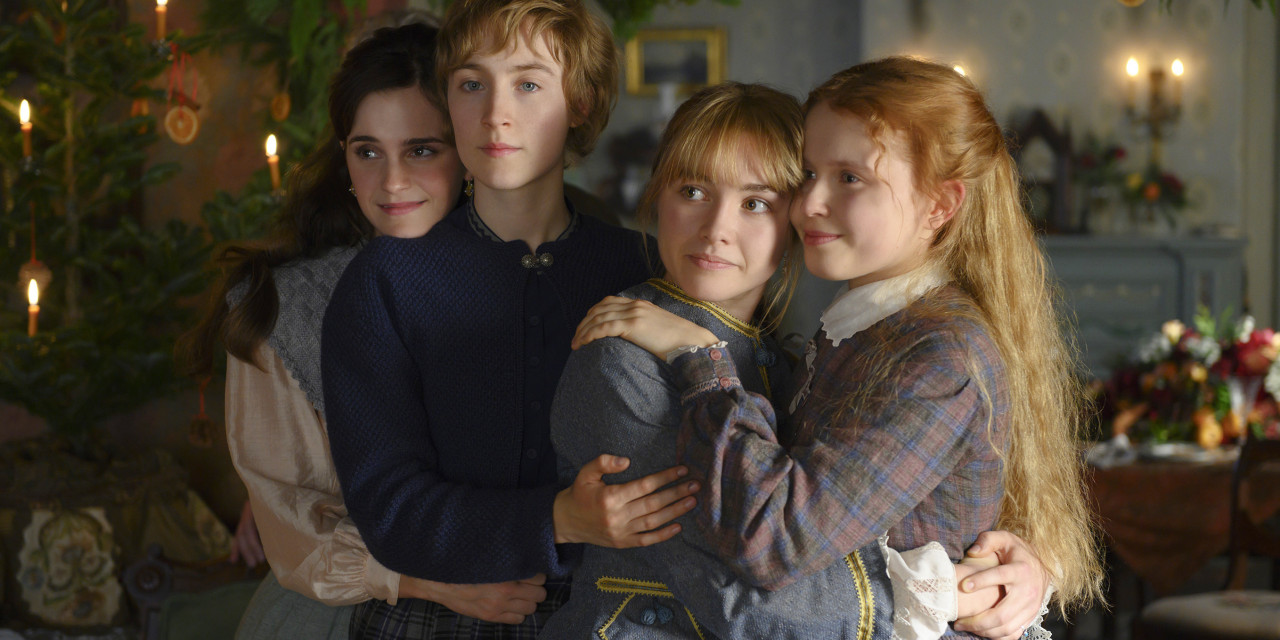



















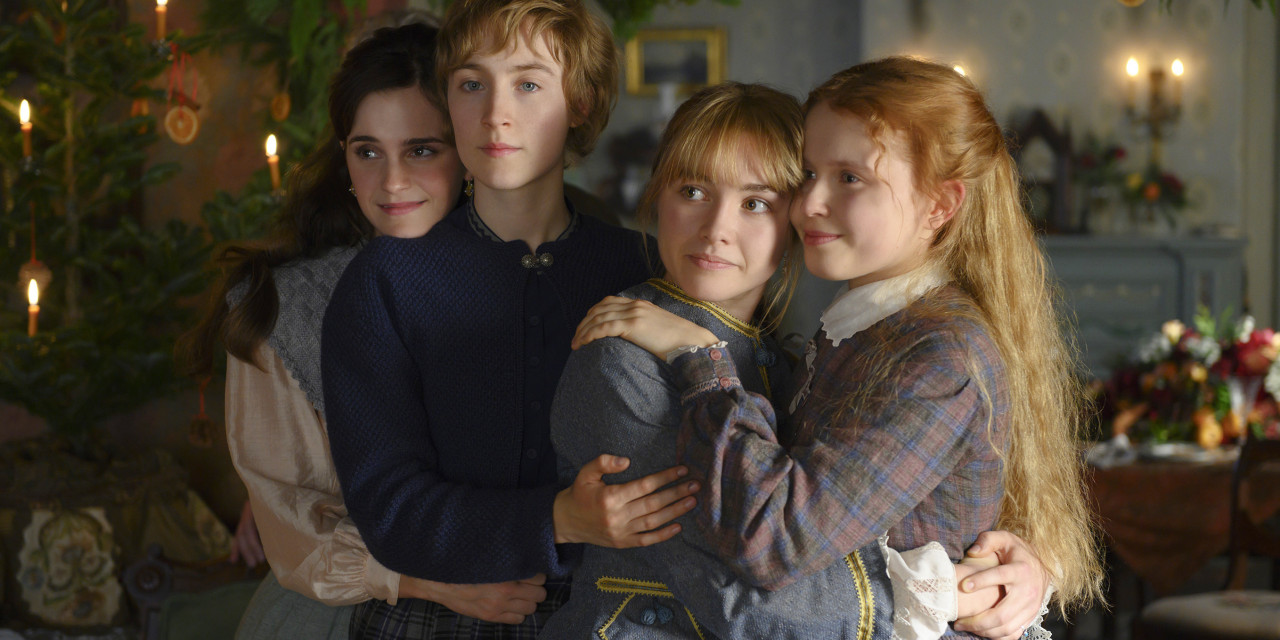
Je l'ai ressorti à cause de mon intérêt pour les années 40, et de l'affaire de l'interdiction débile dans une école américaine. Et pour voir finalement ce que ça me disait encore.
Je ne vais pas raconter le livre ici. J'avais oublié l'articulation très présente du double récit, "contemporain" de la rédaction et historique à travers le témoignage. Le livre est un exemple remarquable de témoignage de seconde main (l'auteur n'a pas vécu les camps de la mort), posant très clairement le lieu de l'énonciation : qui parle, avec quel point de vue, de quel endroit. Ce qui rend le récit à la fois totalement subjectif (voire doublement subjectif) et vrai et crédible.
Je ne vais pas en rajouter. C'est un très très très bon livre, autant sur l'extermination des Juifs en Pologne que sur les survivants, les relations père-fils... A la fois effrayant et facile à lire et très intelligent.
Mais voilà, faire jouer au jeu de rôle dans un cadre historique donne envie de s'informer sur la période et le cadre. Après avoir regardé le (très bon) un pont trop loin, que je prendrai peut-être le temps de chroniquer ici, je me suis intéressé à la campagne des Alliés en Europe de l'Ouest. Et il s'avère que Daniel Feldmann, dont j'avais beaucoup aimé les biographies synoptiques de généraux, a également co-écrit et publié en 2016 un livre sur l'exact sujet qui m'intéressait.
La campagne du Rhin traite de plusieurs problèmes intéressants. Que faire quand un camp (l'Allemagne) a perdu la guerre, mais refuse de l'admettre ? Et que pour des raisons complexes, mais explorées par exemple dans ce bouquin, la population et les soldats décident de se battre jusqu'au bout ? Que faire quand, comme les Alliés, on a un véritable avantage numérique et matériel, mais pas infini, et qu'on doit venir à bout de cet adversaire ? D'autant que les Anglo-Canadiens arrivent au bout de leurs réserves d'hommes, que les Américains ne veulent pas en envoyer plus, que les Français ont envoyé au repos leurs meilleures troupes (coloniales, à la peau un peu foncée) pour intégrer des FFIs motivés mais pas formés et éviter la formation d'un front communiste sur les arrières. Comment planifier la victoire sur l'Allemagne ? Comment s'y prendre ?
Outre un détail des forces et des opérations, ce livre passionnant nous parle aussi des relations entre Alliés et généraux (pas très bonnes, mais ayant au final un impact minime sur les opérations), explore les plans tels qu'ils ont été conçus et tels qu'ils ont été accomplis et s'intéresse aux raisons qui ont poussé Eisenhower à arrêter les troupes alliées sur l'Elbe alors qu'elles étaient aussi proches de Berlin que les Soviétiques...
La campagne du Rhin étudie tout cela au niveau stratégique et opérationnel et ne se plonge pas, c'est voulu, dans l'expérience du combattant ou les détails du terrain.
Ce qui ne gâche rien, le livre est bien écrit, vivant, appuyé sur des sources de première main. Les auteurs font preuve d'un remarquable esprit de synthèse et livrent une étude solide sur cette campagne peu connue, à l'exception des wargamers, bien sûr.
Je peux maintenant apprécier le rôle de chaque nation Alliée dans ce combat. De l'inexpérience des troupes américaines, au comportement honteux des Français en Bavière, en passant par les "batailles planifiées" des Anglais, l'erreur (admise par lui, ce n'est pas rien) du général Horrocks lançant la seconde vague blindée trop tôt lors des combats près de Clèves...
Et le soir je peux lister pour m'endormir les opérations militaires sur ce front. Wacht am Rhein, Nordwind, Veritable, Grenade, Blockbuster, Plunder, Varsity... Bonne nuit les petits !
La campagne du Rhin - les Alliés entrent en Allemagne (janvier-mai 1945).
Daniel Feldmann, Cédric Mas, éditions économica.
Années 40, encore. Je suis très en retard dans les chroniques de livres lus et films vus pour ce blog, alors je me concentre sur les productions en rapport avec le jeu de rôle, dans le but de livrer une série de références utiles pour futurs MJs intéressés par la période.
À jouer une longue campagne de jeu de rôle dans une période historique précise, on finit par lire des bouquins auxquels on ne se serait pas intéressé auparavant.
Les PJs viennent d'arriver en Allemagne, en 1943, engagés comme profs dans une structure d'enseignement spéciale (imaginaire) fondée par un psychiatre confronté au mythe durant sa jeunesse et un idéologue du Parti. Et je me suis rendu compte que je ne connaissais pas grand-chose de la vie en Allemagne durant la guerre, d'où cette lecture.
Le livre de Nicholas Stardgardt, historien britannique, publié en 2015, trace une histoire du peuple allemand entre 1939 et 1945. C'est un récit chronologique de la guerre, telle que perçue par les civils sur le sol allemand. Ses sources sont des dizaines de correspondances, de journaux intimes, des textes écrits sur le moment, corrélés avec les résultats des nombreuses enquêtes d'opinion des services de propagande et de renseignement du Parti.
Les 800 pages du bouquin se lisent très bien, grâce à un récit de l'histoire très vivant, alternant les considérations générales (ampleurs de destructions, gestion du rationnement, nombres de victimes...) et des détails sur la vie de personnes réelles : une photographe berlinoise, un prof conservateur d'Allemagne de l'Est, un vieil universitaire juif et sa femme - qui traverseront tout ça en restant en vie ! -, un jeune père de famille... Ça donne en quelque sorte le portrait physique et psychologique d'une population sur une période de six ans.
Attention, il faut avoir le cœur bien accroché. Les récits d'atrocités nazies sont nombreux, les complicités horribles, une partie des acteurs du livre assistent ou participent à des scènes traumatisantes. À force de jouer à l'époque et de portraiturer les Allemands en France (où la vie n'était pas drôle) j'avais fini par en atténuer un peu dans mon imaginaire les impressions la guerre à l'Est et la mentalité des nazis qui étaient... comment dire... des propagateurs d'une idéologie destructrice et mortifère. (oui, j'enfonce une porte ouverte, mais ce livre m'a bien remis les points sur les i)
Difficile de résumer les nombreuses découvertes et aspects intéressants du bouquin. Dans la logique des travaux contemporains sur le nazisme (ceux de Johann Chapoutot, par exemple), ce livre resitue la pensée guerrière et nationaliste allemande dans la continuité de celle, européenne, du 19ème siècle et celle de la Première Guerre mondiale. En résumant grossièrement, le peuple allemand était persuadé de mener une guerre de défense (si, si, bravo Herr Goebbels). L'adhésion à la guerre était résignée, mais réelle, bien au-delà de l'adhésion au parti et au gouvernement. Les soldats étaient loyaux et suivaient les chefs et même en 44, des Allemands pas spécialement nazis continuaient à penser sur le Führer était la meilleure personne pour les sortir de la situation noire où ils se trouvaient.
Autre point important : la connaissance de "ce que nous faisons/avons fait aux Juifs" était très partagée (même si pas entièrement informée), beaucoup de gens ont profité de la situation sans montrer de solidarité avec leurs concitoyens. L'analyse de l'effet de l'excellente propagande de Goebbels sur ces sujets (oui, ce sale type était doué) est vraiment très effrayante.
Le livre contient aussi beaucoup de réflexions sur la notion de communauté nationale, rêvée par les gouvernants, en partie incarnée. Sur les solidarités ou absences de solidarités entre les différentes parties de l'Allemagne (le Nord bombardé contre le Sud relativement épargné, les catholiques et les Protestants...), sur le rôle globalement pas à la hauteur des Églises (qui étaient allemandes avant tout). On y parle ravitaillement, rations, politiques sociales des nazis (ben oui), déplacements de population, euthanasie des handicapés (là, l'Église catholique a été efficace. On aurait aimé l'entendre sur les Juifs), culture (30% du budget de la culture allait aux théâtres, qui jouaient presque ce qu'ils voulaient - dingue, non ?), poésie, univers imaginaires intérieurs, rêves de l'après-guerre...
Pourquoi lire ce livre ? Parce que vous avez envie de faire jouer à cette époque ou de vous documenter, bien sûr. Mais aussi, et surtout, pour comprendre combien ces gens nous ressemblent. Combien ils sont avant tout normaux. Victimes parfois, bourreaux aussi, aimant leurs familles, croyant ou pas à leur gouvernement. Comme beaucoup de bons livres d'historien, c'est aussi un livre pour réfléchir à qui nous sommes et à mieux nous connaître.
Il y a beaucoup de n'importe quoi publié sur le thème magiciens+nazis, on touche là à une zone érogène de l'imaginaire. J'ai lu il y a longtemps le matin des magiciens, livre bien fumé que j'avais trouvé rigolo à l'époque (je ne sais pas ce que ça vaudrait à la relecture) et j'avais donc été gentiment imprégné par le délire : les nazis, ces occultistes magiciens qui cherchaient la terre creuse/le graal/l'ancienne Thulé. Un thème bien bien recyclé dans la pop culture (hello Indy !).
Ce bouquin sérieux et sourcé documente le vrai occultisme nazi (pas grand-chose), montre les racines idéologiques, plus ou moins sérieuses, des mouvements nazis et leur encrage dans les mouvements völklich (à traduire plus comme "ethno-nationalistes" que comme "populaires"). Ca permet de remettre les pendules à l'heure. (non, les principaux chez nazis, tout criminels qu'ils soient, n'était plutôt pas des initiés magiques).
La suite est plus flippante, montrant chez différents "passeurs" de la seconde moitié du 20ème siècle l'imprégnation de tout un discours, dont le versant Pauwels Bergier n'est que l'aspect le plus fréquentable, un mythe bricolé d'anciennes civilisations, yoga, vies antérieures, racialisme thuléen, etc, etc, montrant comment ces idées venues du 19ème siècle, longtemps disqualifiées après la défaite allemande de 45, refont surface ici et là, sous la forme de construction imaginaires/idéologiques plus ou moins fumées de la tête.
Et ça nous concerne, nous, les rôlistes.
Tenez, par exemple, est-ce que vous avez déjà visité une "cité perdue" ? Avez-vous déjà appartenu à une "race ancienne et aux trois quarts effacée" qui vous aurait légué quelques grands pouvoirs ? Ca ne fait pas de vous un SS, juste un utilisateur de tropes imaginaires passés par la moulinette de plein de fachos ésotéristes plus moins bizarres mais en fait bien plus ancrés dans notre culture (notamment pop) qu'on ne pourrait l'imaginer de prime abord.
(j'ai été très frappé en lisant les derniers chapitres du livre de voir combien la BD Thorgal, pour ne citer qu'elle, était imprégnée de ce genre de tropes imaginaires)
Bref, une bonne lecture, parfois épuisante à force de dingueries racialistes, qui m'a fait réfléchir et mis plus d'une fois mal à l'aise.
Nous avons regardé ce film de 1941 dans notre exploration du cinéma français sous l'occupation. C'est un film noir pas très sérieux. Six amis se font une promesse : ils vont tenter de faire fortune chacun de leur côté dans tous les coins du monde pendant 10 ans. Les survivants se répartiront la fortune de tous. Et bien sûr, à leur retour en France, ils meurent un par un.
Ca ne casse pas trois pattes à un canard, l'intrigue est assez simple mais les acteurs sont chouettes, notamment Pierre Fresnay et Suzy Delair qui jouent les mêmes personnages que dans l'assassin habite au 21 et c'est normal puisque l'assassin est en fait la suite de du dernier des six. On l'a regardé avec plaisir, tout en sachant que ce n'était pas immense.
A noter, d'improbables numéros de danse avec des girls très déshabillées, insérées parce que le récit se passe en partie dans un music-hall. On ne s'attendait pas à ça dans la France de Pétain !
Littérature, magie, seconde guerre mondiale... Ma campagne Cthulhu années 40 m'a donné envie de relire (cet été, ça date un peu) le roi des aulnes.
Donc Abel Tiffauges est un ogre, graphomane et porteur d'enfants. Ce roman raconte son épopée, depuis le pensionnant Saint-Christophe jusqu'à un château prussien abritant de jeunes garçons aryens en passant par un garage, un pigeonnier, un marécage, un immense terrain de chasse...
J'avais en le relisant les images du film de Schöndorff bien présentes en tête - ce qui prouve que l'adaptation était assez réussie.
Pour ceux qui ne l'ont pas encore lu : le roi des aulnes est un très bon roman. Bien écrit, puissant, charriant des flots d'idées énormes et magnifiques, une très belle plongée dans la psyché d'un homme qui se prend pour une créature imaginaire.
Il ne pourra toutefois pas servir d'inspiration à vos scénarios : une des limites de la méthode littéraire de Tournier est que son livre forme un système de symboles et d'idées tressé si fort qu'il est difficile à votre propre imagination d'y trouver sa place.
Qu'est-ce qui permet de dire qu'un général est un bon général ?
Ce livre d'histoire militaire s'intéresse au métier de général de corps d'armée ou d'armée du côté allié durant la Seconde Guerre mondiale. Pour ceux qui, comme moi, ne sont pas très au fait des choses militaires, il s'agit d'officiers qui commandent de 50 000 à 300 000 hommes (quand même) sur des théâtres d'opérations grands d'une centaine de kilomètres. En livrant cinq biographies de généraux dans cette position (les Américains Patch, Hodges et Patton, le Canadien Crerar et le français de Lattre de Tassigny) le livre tente d'identifier ce qui fait et ce que fait un "bon" général : un général capable de mettre ses troupes en mouvement vers un objectif et de commander efficacement son armée, d'atteindre des objectifs à forte valeur militaire tout en épargnant l'outil que lui a confié son gouvernement (la vie de ses hommes, en fait, rien que ça).
Je ne suis ni un grand lecteur d'histoire ni d'histoire militaire et encore moins amateur de panzer porn, mais j'ai vraiment beaucoup aimé lire ce livre : une fois ouvert, je ne l'ai pas lâché.
Bien sûr, Daniel Feldmann est un bon ami et je n'avais pas eu l'occasion jusque récemment de lire ses productions dans le domaine de l'histoire militaire. Lire les livres d'un ami est une bonne manière de rester proche et de le connaître mieux. De plus je lis en ce moment toutes sortes de choses sur les années 40, pour des raisons rôlistiques (mais ma campagne n'a rien de mili).
Ça n'explique pas tout.
Le livre approche le métier de général sous un angle analytique de consultant ; les biographies sous lues et analysées avec deux axes principaux : comment le général établit-il son autorité ? est-il efficace ? Si cette analyse est sans doute pertinente pour les théoriciens de la chose militaire, et si elle forme le point d'entrée du livre, elle n'est pas ce qui m'a le plus intéressé.
J'ai avant tout aimé le drôle d'objet littéraire formé par les biographies de ces cinq hommes, faisant le même métier et se retrouvant tous à combattre sur le même théâtre d'opérations (en gros, France et Allemagne) fin 44 et début 45. Ces lignes narratives montrant cinq hommes aux caractères différents, parcourant la même période de l'histoire donnent une vision synoptique de l'époque et de la guerre, sous un angle original et passionnant. Le style précis du livre, toujours plaisant, permet de connaître ces personnages en quelques dizaines de pages chacun et parvient à les rendre présents et vivants. On se prend à apprécier la modestie efficace de Patch, à s'énerver contre de Lattre, à avoir envie de donner des baffes à quelques autres. Le récit laisse percevoir les drames, aussi bien personnels (presque tous ont perdu un fils dans la guerre, l'un d'entre eux s'est effondré sous la pression) qu'historiques : les combats inutiles, les offensives où se perdent des milliers d'hommes, les hivers misérables de la troupe...
La guerre est grand et puissant récit. Quoi qu'on pense de l'armée ou de la chose militaire (l'auteur de ces lignes n'est pas un grand admirateur de l'uniforme), ces centaines de milliers d'hommes se battant à l'aide de machines terrifiantes durant des mois et des années sont les héros d'un récit vertigineux, dans toute son absurdité meurtrière, et on peut penser qu'il y a peu de métiers plus fascinants (dans l'horreur ou dans la technicité) que de devoir diriger ces opérations. L'objet du livre y trouve toute sa justification.
Je ne sais pas dire ce que vaut Ils ont mené les alliés... en tant que livre d'histoire militaire ou en tant qu'analyse du leadership d'officiers alliés. Mais par son objet, par son écriture, par sa capacité à rendre vivants ses personnages, il forme une intéressante réussite littéraire. À quand le tome 2 décrivant de la même manière les généraux allemands, italiens ou japonais ?
Alias Caracalla est un livre de souvenir du résistant Daniel Cordier, qui vient de nous quitter à l'âge de cent ans. J'avais découvert le personnage dans la chouette émission de arrêt sur images dont il était l'invité. J'avais aimé sa légèreté, son esprit, son humilité. Un type étonnant.
Caracalla, c'est son pseudonyme de résistant. Pas le vrai, en fait, mais celui que l'écrivain Roger Vailland lui a donné dans son très bon roman sur la résistance écrit pendant la résistance. Le passage évoquant Cordier/Caracalla, la scène des gateaux dans le restaurant, est un de plus touchants du livre et, d'après Cordier, il est vrai.
Alias Caracalla est un étonnant livre de mémoires, écrit très longtemps après les faits mais appuyé sur de nombreuses recherches, racontant l'engagement du jeune Daniel dans la résistance. Depuis la capitulation de juin 40 jusqu'à l'arrestation de Jean Moulin.
On y verra l'évolution idéologique du jeune homme, de jeune camelot du roi antisémite à quasi socialiste, on découvrira les rencontres avec De Gaulle, l'entraînement en Angleterre, l'énergie, la frustration, puis toute une étonnante vie de fonctionnaire de la résistance quand Cordier devient à Lyon le secrétaire de celui qu'il admire, Jean Moulin. Ce n'est pas la même vision de la résistance que celle de Lucie Aubrac (même si ça se passe dans la même ville). Cordier se planque, transmet des messages, coordonne, distribue de l'argent... On découvre une vie de stress et d'ennui, au coeur des réseaux, là où se décide la politique des mouvements de résistance, quand Moulin, envoyé de De Gaulle, tente de fonder le mythique CNR.
Le livre est facile à lire, précis, souvent intéressant, parfois ennuyeux dans sa méticulosité et sa précision. Cordier parle de lui quasi comme d'un étranger, un homme d'avant d'où naîtra l'homme de maintenant. Le plus étonnant dans cet étonnant destin est la manière dont quelques mois de collaboration avec un homme qu'il admire forgeront le parcours de toute une vie.
Détestant l'ambiance "ancien combattants", Cordier se détachera de la résistance et des honneurs dans la fin des années 40, deviendra marchand d'art (suite à sa découverte de l'art moderne avec Moulin), puis consacrera la fin de sa vie à défendre un internationalisme dans lequel je me reconnais, et la mémoire de son mentor.
Pour être entièrement honnête, j'avais seulement l'intention de lire les premières pages, "pour voir comment c'était fait", puis je me suis retrouvé à tout lire en quelques jours tant j'ai apprécié le livre. Il n'est pas très long, écrit de manière synthétique mais très facile d'accès et j'ai trouvé son approche intéressante, sachant qu'au départ je n'avais aucune opinion (ni fascination, ni détestation, rien) pour Erwin Rommel, le général allemand le plus fameux de la deuxième guerre mondiale.
Le livre n'est pas une biographie. Il s'attache plutôt à retracer une carrière militaire, en cherchant à comprendre quel officier était Rommel. Quelles étaient ses compétences, ses atouts, sa vision de la guerre, comment ces éléments ont évolué à travers le temps. Entré dans l'armée par opportunité, Rommel s'est battu héroïquement et plutôt efficacement durant la 1ère guerre mondiale dans les rares opérations de mouvement de ce conflit plutôt statique (en Roumanie et en Italie, je n'avais jamais entendu parler des opérations roumaines), a stagné entre les deux guerres avant de devenir un instructeur très apprécié et sans doute très doué. En 1940, il se retrouve à la tête d'une division de chars qui va participer (entre coups de génie, coups de bluff et grosses foirades) à l'écrasante victoire allemande dans la campagne de France.
Le livre consacre ensuite de longues pages aux campagnes d'Afrique (là aussi, je connaissais très mal). Mélange de coups de génie, de défaites humiliantes et de réussites brillantes... Rommel manque de réussir à prendre l'Egypte, puis ne cesse de prendre des coups quand la situation se retourne fin 42. On le voit enfin en semi-disgrâce, puis devenant un des architectes du mur de l'Atlantique, et enfin tenant efficacement face aux Anglo-Saxons pendant quelques semaines en Normandie après le débarquement. La situation était alors très dure et même l'excellent commandant qu'il était devenu n'a pu la retourner. Le livre se termine par une évocation de sa chute politique, quand il est contraint au suicide après avoir été associé à la conspiration qui a échoué à faire tuer Hitler en juillet 44.
Les éléments biographiques (sa vie de famille, sa trajectoire sociale) et politiques (sa relation au nazisme et à Hitler, sa participation aux atrocités allemandes en Italie fin 43) ne sont pas éludés, mais vus essentiellement pour l'éclairage qu'ils apportent à sa carrière et à ses opérations militaires. Le livre tente un éclairage psychologique et une exploration des ressorts humains du personnage (son goût des honneurs, son égoïsme, mais aussi la manière dont il apprend à écouter, à collaborer, et son étrange fascination pour Hitler). Les auteurs traitent leur sujet sans complaisance ni détestation, leur texte n'est ni du panzer porn, ni une évaluation politique à l'aune des passions de notre temps.
Sans avoir aucune connaissance de ce domaine, j'ai trouvé le livre facile à lire et à comprendre. J'ai été souvent passionné par les développements consacrés à cet étrange métier de la guerre, illustré à travers le cas pratique d'un officier particulier, dans son humanité.
On est loin (à l'autre bout de la carrière de Truffaut) de l'énergie des 400 coups ou de la légèreté de Jules et Jim, c'est du cinéma de grande classe, grands acteurs, beaux éclairages et une histoire très belle, tournant entièrement autour d'un lieu, un théâtre dont le directeur, juif, a disparu, mais est en fait caché dans la cave. Un théâtre qui continue à faire du théâtre.
Ca parle de plein de choses : de l'art, du fait d'être juif, des relations tordues entre metteur en scène et acteurs et actrices, d'amour, de mise en scène. Généralement les grands acteurs français (genre Deneuve ou Depardieu) m'énervent, là ils sont tout simplement très bons. Le film est très beau, j'ai beaucoup aimé.
Dans le cadre de l'exploration des fictions mettant en scène l'occupation, je me rends compte que j'ai oublié de parler de ce classique. Nous n'avions jamais vu de film de Melville, et nous avions manqué quelque chose.
L'armée des ombres est un film hiératique, presque solennel, d'un sérieux imperturbable, racontant les combats, la clandestinité, les évasions, la vie d'un réseau de résistants. Le discours du film est clair : ils étaient des héros, ils ont dû commettre des actes terribles, la plupart d'entre eux sont tombés sous les coups de l'ennemi.
La mise en scène et l'image (couleur) sont magnifiques, de la scène d'ouverture incroyable (défilé d'Allemands sous l'arc de triomphe pour lequel Melville a engagé des danseurs afin que la scène soit parfaite), en passant par les incontournables de ce genre de récit : parachutages, évasions, exécutions...
Les acteurs assurent, en commençant par Lino Ventura, un monolithe, en passant par Paul Meurisse (dont je suis devenu fan), Jean-Pierre Cassel et Simone Signoret dans un drôle de rôle. On a même droit au colonel "Passy", le vrai chef des services secrets de la France Libre, dans son propre rôle, et à un (faux) caméo du général de Gaulle.
C'est un film d'action, de suspense, ample et shakespearien, raconté avec un sérieux total. Cool.